Fièvre Q : zoonose méconnue, risques pour l'homme et l'animal
La fièvre Q est une maladie infectieuse d’origine bactérienne, transmissible de l’animal à l’homme (zoonose). Causée par la bactérie Coxiella burnetii, elle est souvent méconnue, bien qu’elle représente un risque important pour les éleveurs, les vétérinaires et les travailleurs agricoles. Qu’est-ce que la fièvre Q ? Quelles en sont les causes ? Quels sont ses symptômes et comment la traiter efficacement ? Cet article explore les mécanismes de transmission, les manifestations cliniques et les mesures de prévention à adopter pour limiter les risques d’infection.
C'est quoi la fièvre Q ?
Une infection bactérienne d’origine animale
La fièvre Q est une maladie infectieuse causée par la bactérie Coxiella burnetii. Il s’agit d’une zoonose, c'est-à-dire qu’elle se transmet des animaux à l’homme.
Cette bactérie est extrêmement résistante et peut survivre dans l’environnement sous forme de spores pendant plusieurs mois voire plusieurs années. On la retrouve notamment dans :
- Les troupeaux de bovins, ovins et caprins, qui hébergent la bactérie sans forcément montrer de symptômes.
- Le lait, l’urine et les excréments des animaux infectés, qui peuvent contenir Coxiella burnetii.
- Les placentas et les sécrétions vaginales des animaux lors de la mise bas, qui représentent une source majeure de contamination.
Un risque pour les professionnels du milieu agricole
Les personnes les plus exposées à la fièvre Q sont :
- Les éleveurs manipulant des animaux infectés.
- Les vétérinaires en contact avec du bétail contaminé.
- Les ouvriers d’abattoirs et les travailleurs agricoles, exposés aux poussières et aux aérosols contaminés.
Bien que la transmission interhumaine soit rare, certains cas ont été rapportés lors de greffes ou de transfusions sanguines.
Quelles sont les causes de la fièvre Q ?
Un mode de transmission principalement aérien
L’inhalation de particules contaminées est la principale voie d’infection chez l’homme. La bactérie Coxiella burnetii est présente dans :
- Les poussières agricoles, transportées sur de longues distances par le vent.
- Les fluides biologiques des animaux infectés, notamment le lait, les sécrétions vaginales et le placenta.
- Les excréments et le fumier, qui contaminent les sols et l’air.
Des sources de contamination variées
D’autres voies d’infection existent :
- La consommation de produits laitiers non pasteurisés, bien que cette transmission soit plus rare.
- Le contact direct avec des animaux infectés lors de soins ou de manipulations.
- L’exposition dans les abattoirs et les laboratoires, où les travailleurs sont en contact avec des échantillons contaminés.
Les tiques peuvent également héberger la bactérie, mais elles ne sont pas impliquées dans la transmission à l’homme.
Quels sont les symptômes de la fièvre Q brutale ?
Une maladie aux multiples visages
Dans 60 % des cas, la fièvre Q passe inaperçue ou provoque des symptômes bénins ressemblant à une grippe. Cependant, lorsque la maladie se manifeste, elle peut être aiguë ou chronique.
Fièvre Q aiguë : les symptômes les plus courants
Les signes apparaissent 2 à 3 semaines après l’infection et incluent :
- Fièvre élevée (39-40°C), d’apparition soudaine.
- Maux de tête intenses, parfois accompagnés de photophobie (sensibilité à la lumière).
- Douleurs musculaires et articulaires proches de celles de la grippe.
- Fatigue importante et perte d’appétit.
- Toux sèche et gêne respiratoire, en raison d’une possible pneumonie atypique.
Dans certains cas, la fièvre Q peut provoquer des complications hépatiques (hépatite) ou cardiaques (péricardite, endocardite).
Fièvre Q chronique : un risque plus grave
Chez 5 % des patients, l’infection évolue vers une forme chronique, qui peut se développer plusieurs mois voire plusieurs années après l’exposition.
Les complications les plus fréquentes sont :
- Une endocardite chronique, touchant les valves cardiaques, potentiellement mortelle sans traitement.
- Une fatigue chronique sévère, qui peut durer plusieurs années.
- Des atteintes neurologiques ou hépatiques, dans les cas les plus graves.
Quelles sont les recommandations pour le traitement de la fièvre Q ?
Un traitement antibiotique efficace
La fièvre Q est traitée par des antibiotiques, qui permettent de contrôler l’infection et de prévenir les complications.
- En cas de fièvre Q aiguë, le traitement repose sur la doxycycline (100 mg, 2 fois par jour pendant 14 jours).
- En cas de forme chronique, une bithérapie antibiotique prolongée (doxycycline + hydroxychloroquine pendant 12 à 18 mois) est nécessaire.
Sans traitement, la forme chronique peut être mortelle dans 25 à 60 % des cas.
Mesures de prévention et recommandations sanitaires
Pour limiter la transmission de la fièvre Q, une approche préventive globale est nécessaire, impliquant à la fois des mesures individuelles et collectives :
Pour les professionnels exposés (éleveurs, vétérinaires, personnel d'abattoir) :
- Porter systématiquement un équipement de protection individuelle adapté : masque FFP2 (et non chirurgical) obligatoire lors des mises-bas ou manipulations de produits à risque (placentas, avortons)
- Utiliser des gants jetables et une tenue de protection spécifique, idéalement à usage unique
- Se laver soigneusement les mains avec un savon antiseptique après tout contact avec les animaux
- Isoler les femelles gestantes avant la mise-bas dans un local dédié et facile à désinfecter
- Éliminer rapidement les placentas et produits d'avortement (incinération recommandée) sans manipulation à mains nues
- Éviter de générer des aérosols lors du nettoyage des locaux contaminés (proscrire le nettoyage à haute pression sans protection)
- Limiter l'accès aux exploitations aux seules personnes nécessaires, particulièrement pendant la période des mises-bas
Au niveau des troupeaux :
- Dépister régulièrement les animaux, notamment avant tout mouvement d'animaux entre élevages
- Mettre en place des protocoles de gestion des avortements avec signalement obligatoire au vétérinaire sanitaire (obligation légale en France)
- Appliquer un protocole de désinfection rigoureux des bâtiments d'élevage avec des désinfectants spécifiquement efficaces contre C. burnetii (ammoniums quaternaires, eau de Javel à 2%)
- Gérer les effluents d'élevage par compostage à haute température (>70°C) pendant plusieurs semaines pour inactiver la bactérie
- Vacciner les troupeaux à risque (avec Coxevac®, seul vaccin autorisé en Europe) - stratégie particulièrement efficace lorsqu'elle est mise en place avant les premières gestations
Pour le grand public, notamment le personnes à risque (femme enceinte, valvulopathie) :
- Consommer exclusivement des produits laitiers pasteurisés ou thermisés
- Éviter les visites dans les fermes pendant les périodes de mise-bas
- Se tenir à distance des exploitations lors d'épandage de fumier, particulièrement par temps venteux
- Pour les personnes à risque (immunodéprimés, valvulopathies cardiaques), éviter tout contact avec les ruminants domestiques
En France, la fièvre Q n'est pas une maladie à déclaration obligatoire chez l'homme (sauf dans certains départements), mais elle fait l'objet d'une surveillance épidémiologique renforcée. La vaccination humaine n'est disponible qu'en Australie et n'est pas commercialisée en Europe, où elle reste réservée à certaines catégories professionnelles dans le cadre de protocoles spécifiques.
L'avis du Dr Timothée Audouin
En tant que vétérinaire, je tiens à souligner l'importance du signalement de tout avortement en élevage de ruminants, la fièvre Q étant l'une des principales causes d'avortement pouvant mettre en danger la santé publique. Contrairement aux idées reçues, cette zoonose touche autant les petits élevages familiaux que les structures professionnelles - on observe d'ailleurs une recrudescence de cas liés aux "mini-fermes" et à l'élevage amateur de chèvres. Les personnes souffrant de valvulopathies cardiaques doivent impérativement informer leur médecin de toute exposition professionnelle aux ruminants, la forme chronique de la maladie pouvant provoquer des endocardites graves sur valves pathologiques même des années après l'infection initiale. Pour les éleveurs, j'insiste particulièrement sur la vaccination préventive des troupeaux, seule mesure véritablement efficace à long terme pour réduire l'excrétion bactérienne et protéger simultanément la santé animale et humaine.
Dr Timothée Audouin
Vétérinaire
Je suis Timothée Audouin, docteur vétérinaire installé en Mayenne depuis 2006. Passionné par mon métier, j’aime partager et diffuser mes connaissances... Voir le profil
Références
- ANSES – AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL. Fièvre Q : ruminants, humains. Disponible à l’adresse : https://www.anses.fr/fr/content/fievre-q-ruminants-humains
- MSD MANUALS. Fièvre Q. Disponible à l’adresse : https://www.msdmanuals.com/fr/professional/maladies-infectieuses/rickettsia-et-microrganismes-apparent%C3%A9s/fi%C3%A8vre-q#Symptomatologie_v1009489_fr
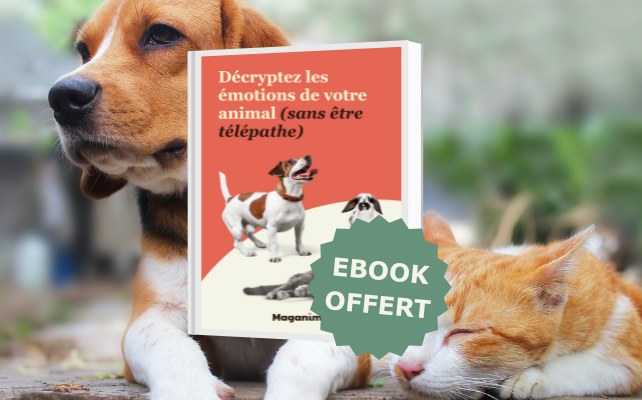
Abonnez-vous !
Recevez chaque jour des conseils d'experts pour prendre soin de votre animal de compagnie.
*Votre adresse email sera utilisée par Digital Prisma Players pour vous envoyer votre newsletter contenant des offres commerciales personnalisées. Elle pourra également être transférée à certains de nos partenaires, sous forme pseudonymisée, si vous avez accepté dans notre bandeau cookies que vos données personnelles soient collectées via des traceurs et utilisées à des fins de publicité personnalisée. A tout moment, vous pourrez vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement intégré dans la newsletter et/ou refuser l’utilisation de traceurs via le lien « Préférences Cookies » figurant sur notre service. Pour en savoir plus et exercer vos droits , prenez connaissance de notre Charte de Confidentialité.



